La saga Resident Evil fait partie des licences phares du jeux-vidéo, malgré des hauts et des bas constatés au fil de son évolution. Au début des années 2000, elle semblait avoir perdu ce qui faisait d’elle la reine du jeu d’horreur. Pourtant tout avait parfaitement commencé grâce à la trilogie initiale sortie sur Playstation 1 définissant les règles de tout bon survival horror de la fin des années 90. Mieux, le premier épisode a été un des précurseurs de ce qu’est devenu le 10e art de façon générale. Retour sur les débuts de cette série qui fit rentrer le média dans l’âge adulte.
Here comes a new challenger !
Le début des années 90 est marqué par la grande rivalité entre Nintendo et Sega. L’un comme l’autre s’affronte à coup de mascotte et affiche une 2D détaillée. Le point commun reste de proposer des expériences ludiques proches du divertissement. Les ambitions scénaristiques, quand elles sont présentes, ne sont là que pour offrir un but, un prétexte pour enchaîner les niveaux et finir le jeu.
Cette façon de penser le jeux-vidéo est appuyée par le monde de l’arcade encore bien présent en ce début de décennie. Les bornes sont conçues pour offrir des aventures concentrées sans trop s’étaler afin d’être rentables. Les longues histoires aux ambitions narratives et à la mise en scène plus poussées n’ont pas leur place sur ces machines. L’heure est plutôt aux concepts simples et aux parties rapides comme dans les jeux de sports, les shmups ou encore les Beat’em All.
Cette philosophie de conception produira des titres aux univers généralement bon enfant, séparés en niveaux bien distincts et dont les ennemis présents ne sont là que comme obstacles disposés pour le joueur, sans aucune tentative de mise en scène. De ces faits, début 90, le jeux-vidéo trimballe avec lui une image de jouet pour gamin auquel les gens sérieux ne s’y intéressent pas.
À la moitié des 90s, à l’aube d’une nouvelle génération de console et de la révolution 3D, Sony va trancher net en termes de ton et d’univers proposés en dévoilant la Playstation. Il va laisser à Nintendo et Sega la garderie pour aller jouer dans la cour des grands, évitant la collision frontale avec ses deux concurrents directs. Avec sa machine, Sony vise un public plus mature, à l’image de sa campagne de pub du Comité Anti-Playstation, et joue la carte de la provocation. Mais si le marketing est bien rôdé, dans les faits il faut encore convaincre avec des jeux.
You have entered a world of survival horror !
Les premiers mois d’existence de la console, on assiste d’ailleurs plus à une suite logique de ce qu’il y avait sur les consoles d’ancienne génération, certains titres gardant même la 2D. On y trouve surtout des jeux de course (Ridge Racer, WipeOut), de combat (Tekken, Toshinden), du schmup ou de la plateforme (Rayman). Même si la 3D impressionne, l’héritage de la 2D n’est pas très loin et Sony n’a pas encore trouvé son ambassadeur pour rompre avec le passé.

Au milieu de ces titres, en août 1996, sort Resident Evil. Le jeu s’impose directement chez les joueurs comme chez la critique. Il détonne clairement avec ce qui sort sur la machine de Sony et propose une aventure sombre, savamment mise en scène et aux graphismes réalistes (pour l’époque).
On y incarne soit Jill Valentine, soit Chris Redfield, tous deux membres de l’unité d’élite des STARS partie sauver leurs coéquipiers portés disparus dans les alentours de Raccoon City. L’équipe se retrouve coincée dans un vieux manoir avec pour objectif de découvrir le sort de leurs compagnons, ainsi qu’un moyen d’évacuer la zone tout en échappant aux griffes des créatures qui y ont élu domicile.
Ces monstres issus des classiques du cinéma d’horreur forment le bestiaire de base du titre. On y retrouve des plantes mutantes, un mégalodon, des expériences génétiques sur pattes et principalement des zombies, ceux qui sont lents et désorientés façon Georges Romero, dont l’étroitesse du décor et leur nombre les rendent dangereux.

Pour amener plus de vraisemblance aux lieux, ces créatures ont été l’objet d’une mise en scène soignée. On aperçoit par exemple des morts-vivants occupés à manger un cadavre, à l’image de notre première rencontre avec l’un d’entre eux, scène accentuée par une cinématique devenue culte. De la même manière, certaines pièces voient surgir les chiens à travers les fenêtres ou par dessus des grilles.
On retrouve également, ici et là, des notes donnant plus de profondeur au manoir ou témoignant de la dégradation de la situation. Ces bouts de journaux ou de rapport nous laissent imaginer comment les choses en sont venues à cet état. Mention spéciale au journal du jardinier qui raconte la transformation en zombie de son propriétaire.
Cette mise en scène permet de nous surprendre et d’instaurer un climat d’incertitude sur ce qu’il peut se passer lors de notre aventure. Les ennemis ne sont pas là à nous attendre pour servir de chair à canon, mais peuvent surgir d’une partie du décor qu’on pensait sans danger. Certains sont même trop occupés à étriper un corps pour réagir directement. Ces détails participent non seulement à l’ambiance du titre, mais contribuent énormément à nous immerger dans le manoir, lui donnant, paradoxalement, un peu plus de vie.

Inspirations et influences
Ce feeling série B instauré par les monstres et la mise en scène trouve leur origine à travers l’influence indirecte de Romero et plus précisément Dawn of the Dead sur Mikami, le game designer du jeu. Le film raconte l’histoire d’un groupe de survivant à l’apocalypse zombie trouvant refuge dans un centre commercial. Après avoir sécurisé un endroit servant alors de base sûre, ils partent explorer le centre commercial à la recherche de ressources comme des armes, des munitions, et tout ce qui peut être utile à leur survie.
Resident Evil arrive à recréer cette sensation en incorporant les Safe Room, seul endroit où on peut sauvegarder et vider notre inventaire dans une malle centralisant tout ce qu’on ne veut pas porter sur nous, tout en sachant qu’on n’y risque rien. Cet endroit, on ne le quittera que pour repartir à l’exploration du manoir, à la recherche de munitions, de soins et d’items aidant à notre progression.
Dans cette pièce, on se sent soulagé et on peut se préparer mentalement à la route à employer pour atteindre notre objectif. Au début, tout est à découvrir et la prochaine Safe Room peut se trouver n’importe où. L’objectif est alors d’explorer et de résoudre certaines énigmes ou de collecter des items pour leur résolution sans savoir quand on pourra se reposer, si ce n’est en revenant sur nos pas. Dans un second temps, une fois les lieux en partie domptés, on peut préparer sa route plus facilement en se fixant d’atteindre tel ou tel endroit pour aller résoudre une énigme et en évitant une zone ou l’autre qu’on craint particulièrement.
Ce rapprochement avec le cinéma d’horreur va jusqu’à emprunter ses côtés les moins reluisants pour offrir au titre son côté nanar. Le scénario s’embarque dans une histoire de laboratoire secret où y sont développées des expériences génétiques menées par la société Umbrella Corp, le tout révélé sous fond de rebondissements et trahisons.
Pour appuyer cette narration, le jeu s’articule autour de moments clés sous forme de cut-scenes soit jouées par des acteurs peu convainquant lors des cinématiques en FMV, soit in-game où chaque syllabe est particulièrement articulée dans des dialogues qui en deviennent ridicules.

De façon plus globale, Resident Evil emprunte au cinéma le travail sur le placement des caméras. Chaque plan est fixe et les caméras se relaient selon le placement du personnage. Ces plans fixent sont l’occasion de pouvoir travailler chaque cadrage en utilisant des règles de composition venues du cinéma. Plongées et contre-plongées accentuent le sentiment d’oppression qu’on ressent et le hors-champ permet de dissimuler les zombies qu’on entend à quelques mètres de nous.
Si ce côté cinématographique permet de renforcer la sensation de parcourir un vieux film de Romero, c’est aussi une évolution majeure pour le jeux-vidéo. En cela, Resident Evil fait office de pionnier et annonce la direction qu’est en train de prendre l’industrie vidéoludique, comme en témoignera, quelques années plus tard, Metal Gear Solid poussant encore plus loin une réalisation proche du cinéma.
L’avènement du Survival Horror
Si Resident Evil est important pour ce qu’il annonce en termes de réalisation, le titre va également se distinguer par sa fusion entre son gameplay et cette volonté d’effrayer le joueur. Cet alliage parfait va définir les codes d’un genre entier pour le reste de la décennie.
Pour créer l’aspect survie du titre, le jeu s’appuie sur une rigidité de déplacement. Concrètement, le joueur tourne le personnage sur lui-même pour lui faire prendre une direction avant de le faire avancer en avant ou en arrière, à la manière d’un tank. Une mécanique particulièrement stressante quand un zombie s’approche et qu’il faut faire demi-tour en se tournant sur soi-même. Des déplacements qui renforcent encore le côté série B lors des scènes in-game, car aussi naturels que le jeu des acteurs.
Mais la grande force de Resident Evil se trouve dans la limitation des ressources. Les munitions et les soins sont en quantité limitée, l’inventaire ne permet qu’un nombre maximal d’items d’être stockés et même les sauvegardes ne peuvent s’effectuer qu’avec des rubans encreurs, eux aussi présent au compte-goutte.
Chacune de ses limites va avoir un effet sur la façon d’appréhender l’exploration. Si l’inventaire a un nombre de places défini, on peut déposer ce qui ne nous sert pas dans la malle disponible dans la Safe Room. Si estimer la quantité de soin et munition nécessaire pour progresser est assez facile, on se retrouvera cependant plus d’une fois face à une énigme nécessitant un item resté dans cette malle. On devra alors faire le chemin inverse pour aller le chercher. Des allers-retours qui engendrent encore plus de situations délicates.

Ces situations sont l’occasion de devoir peser le pour et le contre face à un ou plusieurs monstres. Si utiliser des munitions permet de libérer le passage, c’est aussi risquer de se retrouver démuni dans une situation ultérieure plus coriace. À l’inverse, tenter de slalomer entre les monstres peuplant un couloir peut avoir comme conséquence de se faire mordre et se retrouver à l’article de la mort, voir de perdre une à plusieurs heures de jeu si la morsure a été fatale.
Ces choix fréquents et lourds de conséquences s’appuient beaucoup sur le manque de connaissance du jeu. Plus on affronte de zombies, plus on connaît le danger qu’il représente, ce qu’il peut ou ne peut pas faire et donc les risques qu’on peut tenter de prendre.
Conscient que la peur repose sur l’inconnu, Mikami a parfaitement rythmé son jeu. Tout le level design repose sur des boucles d’explorations. Lors de la première exploration du manoir, certaines pièces sont verrouillées et ce n’est qu’après avoir fait le tour du propriétaire qu’on découvre une clé permettant d’en débloquer de nouvelles. De boucle en boucle, à force de découvrir de nouvelles clés et de débloquer de nouveaux accès, on apprend à connaître son environnement, les couloirs dangereux, ceux où il n’y a plus rien, mais aussi le comportement des monstres et leur pattern. C’est alors que le jeu nous emmène dans un nouvel environnement, l’occasion de perdre ses repères et de devoir à nouveau apprivoiser ce qui nous entoure.
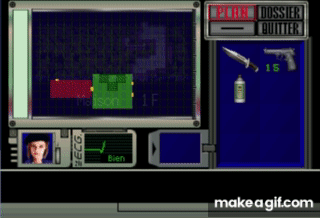
Avec le temps, on a également pu se familiariser avec le comportement des ennemis et la rigidité des personnages, ce qui permet d’esquiver un obstacle plus facilement. Cette maitrise du jeu nous fait nous sentir petit à petit maitre de l’environnement et des dangers présents. C’est à ce moment-là qu’une nouvelle menace est introduite. Un ennemi plus agile et rapide qui vient remplacer les zombies qui erraient jusque là dans les couloirs. De nouveau, les habitudes sont cassées et on est obligé de réapprivoiser cet adversaire.
De la même manière, le jeu propose deux scénarios : un pour Jill Valentine et le second pour Chris Redfield. Ces deux scénarios restent globalement identiques et permettent avant tout de choisir entre deux difficultés de jeu. L’une a plus de place dans l’inventaire, plus de résistance et voit certaines énigmes simplifiées, tandis que pour l’autre, c’est le contraire. Mais cela permet également de refaire l’aventure tout en renouvelant la peur. Bien que l’histoire reste la même pour l’un et l’autre personnage, tout ne se passe pas exactement de la même manière et chacun aborde le manoir dans un ordre différent. Ce nouveau parcourt paume à nouveau nos repères et offre un intérêt particulier à refaire le jeu.

De l’esquisse au chef-d’oeuvre
Sur ces bases, Resident Evil va asseoir sa notoriété de jeu novateur. En plus d’ouvrir les portes de la maturité au jeux-vidéo, il établit également les codes du survival horror qui feront loi jusqu’à la fin des années 90, quitte à voir des clones (plus ou moins réussis) se multiplier.
Le second opus se voit offrir la lourde tâche de lui succéder, chose faite en août 1998. Il est même généralement élu meilleur Resident Evil de cette première trilogie PSX. En parcourant le jeu, il est d’ailleurs clair qu’Hideki Kamiya a brillamment succédé à Mikami pour sortir une version perfectionnant le premier titre qui parait alors comme une esquisse.
Côté scénario, on retrouve l’histoire à deux facettes en incarnant soit Léon S. Kennedy, une jeune recrue en route pour son premier jour dans la police de Raccoon City, soit Claire Redfield, partie à la recherche de son frère Chris Redfield porté disparu à la suite des événements du manoir. Alors que la ville a sombré dans le chaos total et dont les rues sont infestées de zombies, les deux héros se retrouvent coincés dans le commissariat de la ville, lui-même à l’abandon. Comme dans le premier opus, l’histoire fait la part belle aux rebondissements et trahisons, tout en témoignant de l’emprise d’Umbrella Corp. sur la petite ville américaine.

Si encore une fois, d’un scénario à l’autre ce sont les mêmes décors qu’on parcourt, le jeu va ici plus loin dans la différence entre les deux aventures. Lors de son histoire, Léon rencontre Ada, une espionne à la botte d’une société concurrente à Umbrella ; tandis que Claire protège Sherry, la fille du couple Birkin travaillant à la confection d’un nouveau virus pour la corporation au parapluie.
Contrairement au premier Resident Evil, l’idée d’une histoire à double facette est poussée plus loin. Ainsi, les actions menées par Claire auront une répercussion dans l’aventure de Léon, offrant une sensation de destin croisé, chacun s’influençant mutuellement. De même, certains choix effectués avec un des personnages auront des conséquences sur l’autre protagoniste.
Ces choix et actions ne changent fondamentalement pas la donne, mais renforcent la sensation d’avoir deux aventures se passant réellement en parallèle, là où dans le premier, les deux scénarios donnaient plus l’impression de n’être que des modes de difficultés habilement déguisées et amenaient nombres d’incompatibilités entre les deux histoires.
De plus, ce changement de décor pour un contexte urbain permet d’accroître la sensation de perte de pouvoir sur l’environnement. Les choses sont en train de déraper et ne sont plus cloisonnées dans un manoir à l’écart de la civilisation. La menace est plus large, beaucoup plus incontrôlable et les ramifications d’Umbrella développées dans le jeu témoignent d’un pouvoir de la corporation au-delà de ce qu’on pouvait imaginer jusqu’ici.

Niveau gameplay, la formule est respectée dans les grandes lignes. On retrouve le système de déplacement du premier, exception faite de l’état du personnage qui modifie sa course. S’il subit trop de dégât, l’avatar boite et perd en vitesse, ce qui, non seulement augmente les possibilités de se faire croquer, mais est aussi un rappel constant et anxiogène qu’on est dans la merde jusqu’au cou.
Pour le reste, sauvegardes, soins et munitions sont toujours restreints, même si en plus grands nombre que dans Resident Evil 1. Le jeu se tourne légèrement plus vers l’action, tout en gardant un équilibre parfait pour ne pas que le joueur se sente trop pousser des ailes et tirer à tout va en prenant des risques inconsidérés.
Le bestiaire subit aussi une mise à jour avec l’habile et rapide Licker grimpant sur les murs et les plafonds, mais l’apport le plus important est sans conteste le Tyrant. Ce golem intuable poursuit lentement, mais sûrement le joueur et a le don de lui barrer la route. D’autant plus qu’il a l’art et la manière de faire son entrée, défonçant les murs et le décor au besoin, et attendant qu’on l’ait oublié pour refaire surface.

Jill Valentine s’en va t’en guerre
La recette du second opus affine celle du premier épisode et permet de hisser le jeu dans le cœur des fans. Il dose habilement survie et action tout en maitrisant rythme et mise en scène. C’est sans surprise que Capcom prévoit alors plusieurs projets autour de la licence, dont un spin-off qui se transformera en épisode 3 en 1999. Le jeu en portera les séquelles sur certains aspects, même si dans l’ensemble, il continue certaines évolutions entamées par son prédécesseur.
À cheval sur les événements de Resident Evil 2, le joueur incarne Jill Valentine qui lutte pour sa survie dans le chaos de la ville de Raccoon City. Son unique but est de s’échapper de cet enfer. Pour ça, elle n’aura pas d’autre choix que de compter sur l’aide de mercenaires employés par Umbrella pour effacer toutes traces de leur responsabilité dans ce merdier. Dans cette lutte pour sa vie, le Némésis fait son apparition. Cette créature aura pour seul objectif de poursuivre sans relâche les membres de l’équipe des STARS, dont Jill.

Plus de confinement cette fois, on parcourt les rues ravagées de Raccoon City et on navigue entre plusieurs endroits pour trouver de quoi réparer le tram censé nous amener hors de la ville. Ces environnements flirtent sur l’ambiance déjà plus urbaine du second épisode. Et pour cause, certains décors y sont repris après avoir été un peu réarrangés. Jill va jusqu’à faire un petit tour dans le commissariat.
Cette réutilisation d’assets sera décriée à la sortie du jeu, même si cela offre la nostalgie de revenir dans des lieux connus. On les revisite en constatant les changements et en imaginant ce qui a pu se passer entre maintenant et le moment où Léon et Claire vont y entrer. Ces lieux communs sont la conséquence directe de l’origine du projet. De ces chamboulements de développement, il en résulte également l’unique scénario centré sur Jill. Pas d’histoire B pour offrir une rejouabilité et une nouvelle vision sur le scénario comme dans les précédents titres.
Cela n’a pour autant pas empêché Capcom de faire évoluer sa série. Les déplacements se fluidifient grâce à la possibilité de faire un demi-tour rapide. Aoyama, game designer pour cet épisode, apporte même plusieurs mouvements d’esquive. De quoi être plus à l’aise en combat malgré le nombre de zombies encore revu à la hausse. Ces nouvelles capacités et cette augmentation de monstres errants va de pair avec une simplification des règles établies par les deux premiers épisodes conduisant à un titre encore plus orienté action (les munitions se ramassent à la pelle et on dispose de rubans encreurs infinis) sans pour autant en faciliter le titre.

C’est qu’au final, les zombies et les mécaniques de jeu, après deux épisodes, sont connus des joueurs. Le vrai ressort horrifique de ce Resident Evil relève plus du Nemesis, sorte d’évolution au Tyrant du 2e volet. Cet ennemi vient harceler le joueur tout au long de l’aventure, que ça soit à des moments clés du scénario ou lors de l’exploration de l’environnement. Une apparition impromptue qui crée ce sentiment de panique brouillant la rationalité de nos décisions.
Pour le reste, Resident Evil 3 perpétue et finit d’affiner un gameplay qui commence à montrer ses limites. Il peut néanmoins toujours compter sur le soin apporté à la mise en scène. Le feeling de parcourir un film d’horreur bas budget est toujours présent et même s’il n’est pas l’épisode le plus marquant de la série, il reste un des meilleurs survival horror de la Playstation.
Épitaphe
La saga Resident Evil a vu le jour sur Playstation et l’a accompagné tout au long de sa vie, insufflant à la machine l’image mature qu’elle cherchait. Offrant des graphismes gores et réalistes pour l’époque, le jeu tranche sévèrement avec les univers bon enfant jusqu’ici présents sur les consoles de salon. Pile ce qu’il fallait pour que Sony puisse draguer les jeunes adultes.
Mais plus qu’un porte-étendard pour une console, Resident Evil a également été un des symboles importants des 90’s, portant en lui un petit bout de cette époque révolue. Ses astuces de réalisations sont tellement ancrées dans cette fin de millénaire que le découvrir, c’est découvrir en partie cette période. Des Final Fantasy à Oddworld en passant par Sanitarium ou Grim Fandango, les environnements précalculés ont été une esthétique rapidement adoptée à l’arrivée de la 3D polygonale, permettant de contourner les limites des machines existantes pour offrir des décors détaillés pendant que les personnages et éléments sur lesquels interagir restaient en temps réel.

Au-delà de cet aspect graphique, le premier volet, de par sa mise en scène, a annoncé la direction qu’allait prendre le jeux-vidéo. Un soin tout particulier est accordé à la façon d’introduire son sujet, son histoire et ses monstres rendant son univers plus crédible et, dans ce cas précis, plus effrayant. Un soin qui se perpétuera sur les deux épisodes suivants.
Imbriqué à cette réalisation, le gameplay vient parachever l’œuvre en lui donnant son aspect survie. La peur s’infiltre jusque dans le pad à travers des commandes rigides et des ressources limitées. Il définit ainsi un genre à lui seul, en allant jusqu’à lui-même lui donner un nom : le survival horror. À côté, ses concurrents directs font pâle figure. À chaque sortie, ceux-ci sont comparés au maitre sans jamais arriver à l’égaler. Un maitre qui n’hésite pas à nous mettre face aux conséquences de nos choix malheureux nous ayant amenés au game over.


